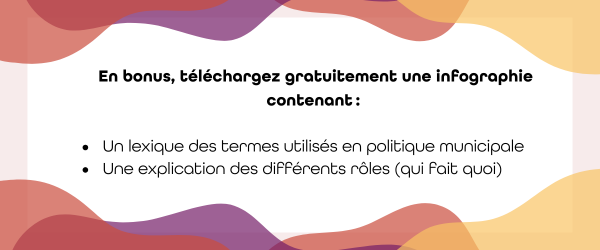Les 100 premiers jours d’un conseil municipal
Au lendemain des élections, on voit des visages souriants, puis les choses sérieuses commencent derrière les portes closes. Entre les calendriers partagés, les comités et les caucus, la machine municipale se met en marche. Voici ce qui se joue partout en Estrie.
La soirée des résultats marque le début d’un nouveau cycle. Dès le lendemain, l’appareil municipal (direction générale, greffe, finances, urbanisme, communications) s’active : organisation du conseil, constitution des comités, premiers arbitrages budgétaires. Les nouvelles élues et nouveaux élus intègrent un système rodé, avec ses rituels et ses contraintes. Sur le territoire estrien, où cohabitent des grandes villes, des centres dynamiques et des municipalités à taille humaine, les activités des conseils municipaux s’enchaînent à un rythme soutenu.
J+0 à J+10 : les pactes initiaux
La séance d’assermentation officialise le mandat, mais l’essentiel se joue dès la première séance : adopter le calendrier des rencontres, nommer la ou le pro–maire, et surtout répartir les présidences de comités. Ces « chaises » comprennent les finances, l’urbanisme, la mobilité, la sécurité publique, la culture et les loisirs.
C’est le temps de prioriser certains chantiers, en retarder d’autres, et négocier des sièges dans les MRC, les régies (eau, déchets, incendie), et les sociétés de transport. Le greffe organise la cadence en déterminant ce qui peut apparaître à l’ordre du jour, et quand.
J+10 à J+30 : le vrai centre de gravité
À partir de cette phase, la carte du pouvoir devient plus claire. Les comités sont le véritable moteur de la démocratie municipale : ce qui n’y passe pas a peu de chances d’atteindre le plénier, cette réunion à huis clos où les élu·e·s préparent les dossiers qui seront ensuite discutés et décidés lors d’une séance publique.
À Sherbrooke, la société de transport (STS) pèse lourd sur les questions de mobilité. À Magog, c’est l’équilibre entre grands projets et entretien (trottoirs, éclairage, parcs) qui se joue d’abord au comité d’urbanisme. Au niveau des MRC, la planification régionale (déchets, sécurité incendie, développement touristique) peut redéfinir les échéanciers des petites villes.
Dans l’ombre, la Direction générale vérifie le réalisme des engagements, le comité des finances trace les garde-fous (taxation, dette), l’urbanisme cadence les projets de construction privés et publics, tandis qu’aux communications on prépare le récit, celui qu’on entendra en séance plénière et dans les médias locaux.
J+30 à J+60 : les premiers arbitrages
Arrive le PTI préliminaire (programme triennal d’immobilisations) avec ses tableaux. Entre entretien de la voirie, projets rapides et chantiers structurants, il faut choisir ! C’est là que prospèrent les compromis politiques : « Ton district obtient l’éclairage sur la 12e Avenue, le mien doit sécuriser le corridor scolaire. » Ces compromis s’appuient sur des critères techniques (achalandage, sécurité, équité territoriale) qui donnent une légitimité aux choix… sans effacer la part politique.
Autour de la table, d’autres forces s’expriment : syndicats municipaux, promoteurs, tables de quartier, organismes communautaires, médias. On teste des messages, on ajuste une fiche de décision, on renvoie certains dossiers à une étude complémentaire. Ici, la parité prend tout son sens en s’assurant de la présence des femmes aux finances, à l’urbanisme ou à la sécurité, afin d’influencer la façon de hiérarchiser les besoins (sécurité piétonne, éclairage, accès aux services, logement, mobilité le soir).
J+60 à J+85 : cadrage des controverses
Nous entrons dans la phase de mise en récit. Les directions produisent des sommaires décisionnels sur les coûts, justifications, risques et alternatives. Le langage est peaufiné afin d’éviter toute surprise désagréable en séance plénière. Les consultations s’enchaînent certaines étant obligatoires (règlements d’urbanisme), d’autres facultatives (rencontres thématiques).
Chaque municipalité jongle avec son propre millefeuille : ville ↔ MRC ↔ régie ↔ partenaires. Un décalage à la MRC peut retarder une annonce dans une ville, d’où les « ajournements techniques » qui frustrent parfois les citoyen·ne·s et les organismes communautaires.
J+85 à J+100 : verrouillage et lignes rouges
C’est le sprint final durant lequel on boucle le budget et le PTI, on règle les derniers arbitrages sur la taxation et les contingences. On fixe aussi les principes (éthique, communications, équité, diversité et inclusion) qui encadreront la suite du mandat. Une liste de dossiers se constitue : projets à reporter, études à lancer, subventions à confirmer.
Ce qui se joue vraiment
En cent jours, un conseil ne réalise pas un programme complet, il dessine les contours des décisions des 12 à 24 mois à venir. Qui préside quoi, qui contrôle quel ordre du jour, quel récit administratif encadre les priorités, voilà ce qui déterminera si les dossiers avancent, patinent ou s’ajournent.
En Estrie, la parité et la diversité au sein des conseils municipaux n’est pas un slogan : elles exercent une influence sur les thèmes qui montent en haut de la pile. Et la prochaine fois que vous entendrez « On a décidé en conseil. », souvenez vous que la décision a souvent pris sa forme bien avant, au détour d’un comité, d’un caucus… ou d’un tableau du PTI.
Vous êtes citoyen·ne engagé·e et souhaitez lire d’autres articles comme celui-ci ? Cliquez ici pour vous abonner à notre infolettre.